« Venezuela, chronique d’une déstabilisation ».
- Opinión
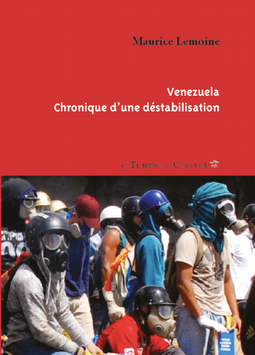
Publié par Le Temps des Cerises, Venezuela – Chronique d’une déstabilisation, de Maurice Lemoine, sort dans les bonnes librairies le jeudi 4 avril 2019. Ex-rédacteur en chef du Monde diplomatique, l’auteur sillonne l’Amérique Latine depuis plus de quarante ans. Parmi ses ouvrages récents, citons “Chávez Presidente !”, « Sur les eaux noires du fleuve », “Cinq cubains à Miami” ou “Les enfants cachés du général Pinochet”. L’occasion de dialoguer avec l’auteur à propos d’une certaine idée du journalisme.
Thierry Deronne – Pourquoi avoir donné à ton nouveau livre la forme d’une « chronique » ?
Maurice Lemoine – Si j’en crois le dictionnaire, une chronique est un récit dans lequel les faits sont enregistrés dans l’ordre chronologique. Cela peut paraître basique, simpliste, limité, loin des brillants exercices théoriques et rhétoriques des analystes « top niveau ». En tant que journaliste de base, je revendique cette approche. Pour prétendre analyser une situation, encore faut-il connaître les faits. Leur enchaînement. Leurs causes et leurs effets. Leurs conséquences, voulues ou non. Ce qui permet, preuves à l’appui, de mettre en évidence, l’incohérence et la malhonnêteté très significatives, à une poignée de mois d’écart, de certaines prises de position.
Quelques exemples… En 2017, en convoquant une Assemblée nationale constituante, le président Nicolás Maduro provoque les hurlements de l’opposition : en 2014, l’un des dirigeants de cette dernière, Leopoldo López, réclamait une telle Assemblée à grands cris. En 2017, pendant toute la période de violence insurrectionnelle, les principaux dirigeants de la Table d’unité démocratique (MUD) s’égosillent : « Election présidentielle anticipée ! » Le pouvoir l’organise : plus aucun d’entre eux n’en veut ! Mais qui se souvient de leurs déclarations et de leurs revendications antérieures ? Personne (sauf peut-être l’ex-président du gouvernement espagnol José Luis Rodriguez Zapatero, qui a servi de médiateur dans une tentative de dialogue et qui, lors de la rupture de ce dernier sur ordre de l’ « Empire », a exprimé sa réprobation). La mémoire de l’appareil médiatique, elle, ne dépasse pas les trois derniers mois. D’où l’importance de reprendre modestement l’histoire telle qu’elle se déroule, pas à pas.
TD – Que raconte donc cette chronique et en quoi se veut-elle originale, différente ?
ML – Dans la grande tradition du Monde diplomatique, que j’ai « fréquenté », du statut de pigiste à celui de rédacteur en chef, pendant trois décennies, il s’agit d’un travail de « contre-information ». Quiconque subit quotidiennement le rouleau compresseur « Dassault-Lagardère-Bergé-Pigasse-Niel-Drahi-Rothschild-Pinault-Arnaud » (et je ne parle pas des médias étrangers), ainsi que les ex-radios et télévisions de « service public » devenues « chaînes d’Etat », en comprend parfaitement la nécessité. Donc je travaille comme devrait travailler n’importe quel professionnel de la profession : suivi permanent de l’info, rencontres, interviews et reportages de terrain précèdent l’analyse. Le concret avant le « blabla ». Pas de quoi en faire un plat, c’est ce qu’on devrait apprendre aux jeunes dans les écoles de journalisme. Cela me permet d’échapper à l’ « Histoire officielle », que je résumerais ainsi : plongé dans une crise économique, politique et institutionnelle sans précédent, le Venezuela, pourtant détenteur des plus grosses réserves pétrolières de la planète, s’effondre, gangrené par la corruption, au point de ne plus pouvoir apporter ni nourriture, ni médicaments, ni produits de première nécessité à sa population. Alors que l’opposition a été complètement muselée, la « société civile », « affamée », lorsqu’elle se révolte et manifeste « spontanément », est réprimée à feu et à sang. Ce qui a permis à Maduro, contrôlant désormais toutes les institutions de l’Etat, de se faire réélire, dans des conditions fortement contestées, le 20 mai dernier. Pour la « communauté internationale » – c’est-à-dire les Etats-Unis, l’Union européenne et certains pays d’Amérique latine –, le Venezuela s’enfonce petit à petit dans la dictature.
Cette « Histoire », induite par une propagande tentaculaire, il y a une autre façon de la raconter.
TD – Quelle est donc la thèse que tu développes dans ton livre ?
ML – A la mort de Chávez, et afin de neutraliser définitivement la « révolution bolivarienne », les secteurs radicaux de l’opposition, en lien avec la Maison-Blanche, le Pentagone et le Département d’Etat, ont entrepris d’empêcher à n’importe quel prix son successeur Maduro, bien qu’élu démocratiquement, de consolider son pouvoir. Se référant de façon subliminale aux « révolutions de couleur », jouissant d’un fort appui international, ils ont lancé de violentes offensives de guérilla urbaine en 2014 et 2017 (45 et 125 morts), dont une partie importante des victimes, contrairement à ce qui a été dit et écrit, n’appartenaient pas aux manifestants.
Certes, l’importante diminution des prix du pétrole, la principale ressource du pays, a raréfié la rentrée des devises, rendant plus difficiles les importations de biens de consommation. Certes, la gestion du gouvernement ne brille pas toujours par son efficacité. Mais, les ratés réels de son administration n’expliquent pas tout. Des pénuries organisées et de l’accaparement des aliments, médicaments et biens de première nécessité, aux conséquences désastreuses du marché noir, en passant par une inflation irrationnelle sciemment provoquée, auxquels s’ajoutent depuis 2015 les sanctions américaines, c’est bien, depuis l’arrivée de Maduro au pouvoir, une déstabilisation économique qui sème le chaos. En réalité, le pays subit une guerre totale et multiforme qui a atteint son climax le 4 août 2018 avec la tentative d’assassinat de Maduro par un attentat aux drones explosifs et l’auto-proclamation le 23 janvier 2019 d’un président fantoche, Juan Guaido.
TD – Cette interprétation des événements est loin de faire l’unanimité. En quoi t’estimes-tu plus crédible, plus neutre ou plus objectif que ceux auxquels tu opposes cette version des faits ?
ML – Terminons-en avec un mythe. L’objectivité, ça n’existe pas. Déjà, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, l’Athénien Thucydide constatait : « Ceux qui ont assisté aux événements ne les rapportent pas de la même manière et parlent selon les intérêts de leur parti ou selon leurs souvenirs variables. » Beaucoup considèrent le journaliste comme un acteur isolé, omnipotent, capable de faire surgir par l’analyse et l’enquête des vérités non connues au départ. En fait, il n’est qu’un acteur parmi d’autres, dans un système d’ensemble. Il fait partie de la comédie. Il sélectionne ses sources sur la base de ses critères conscients ou inconscients, de leur accessibilité, de leur légitimité, mais aussi en fonction de ce qu’attendent son rédacteur en chef et le directeur de la publication. Qui ne tiennent pas forcément à être montrés du doigt pour un traitement non « pensée conforme » de la situation du Venezuela. Et je ne parle pas de la corporation des éditorialistes qui, se prenant pour les instituteurs du genre humain, se contentent de donner leur avis sans jamais assister à rien (ils ont trop peur des insectes, des bestioles et des microbes exotiques, ces malheureux !).
S’y ajoutent les contraintes d’un secteur économiquement en difficulté : les bons articles sont d’abord ceux qui ne coûtent pas trop cher, en période de budget publicitaire un peu serré. Sans compter les obligations du rythme de « l’info en continu » ; pour une minute trente, il faut axer sur un personnage : Chávez, hier avant-hier ; Maduro, hier ; Guaido aujourd’hui. Le contexte ? Alignons-nous sur les confrères, quitte à créer une « vérité alternative », avec, si nécessaire, oublis, truquages et manipulations à l’appui.
Plutôt que d’objectivité, parlons d’honnêteté – ce qui, indépendamment des différences d’analyse, serait déjà un grand progrès. Mieux vaut un journaliste de droite honnête – il y en a – qu’un pseudo progressiste qui, en catimini, afflige les faibles et soutient les puissants – il y en a hélas aussi, et beaucoup.
TD – Justement, l’honnêteté n’implique-t-elle pas de rester neutre ?
ML – En certaines circonstances, la neutralité porte un autre nom : « lâcheté ». On n’est pas neutre entre les Juifs et les nazis ; entre la République espagnole et le général Franco ; entre Salvador Allende et Augusto Pinochet ; entre la révolution sandiniste et la « contra » ! Qu’on me pardonne d’insister. La grave crise que traverse le Venezuela comporte une dimension systématiquement passée sous silence : comme en son temps le Chili de Salvador Allende, il fait face à une sournoise (de moins en moins, d’ailleurs) mais féroce (et de plus en plus) déstabilisation. Il possède trop de pétrole et trop de richesses minérales pour laisser Washington indifférent… Dans de telles conditions, notre rôle n’est pas de diffuser du gnan-gnan pour Bisounours bien-pensants.
TD – Et pourtant, certains secteurs de la gauche dite « radicale » ou de l’extrême gauche françaises campent sur une critique virulente du « régime » de Maduro.
ML – C’est terrible. Affligeant. Pour reprendre l’argumentation d’un certain Thierry Deronne – tu connais ? –, que j’ai vue passer récemment, « le sens commun sédimenté par l’hégémonie des médias a détaché le mot “Venezuela” du réel d’origine pour en faire un marqueur de respectabilité. Pour beaucoup de personnalités politiques, revues, journaux, centres de recherche, etc., la question n’est plus “comment enquêter là-bas, comprendre, apprendre”, mais “comment soigner, ici, mon image antitotalitaire dans l’opinion” ». La réflexion me paraît tellement juste que je ne vois pas l’intérêt de me « prendre la tête » pour la paraphraser.
Aux ravages opérés dans l’opinion publique par l’entre soi médiatico-mondain s’ajoute désormais le rôle néfaste dans la mouvance progressiste d’un certain nombre d’ « intellectuels » et d’universitaires dits « de gauche », post-trotskistes, anars et écolos de la « bobosphère » (que je n’assimile pas aux indispensables défenseurs de l’environnement), lesquels ne se définissent que par la négation. « Contre tout ce qui est pour », « pour tout ce qui est contre ». Soucieux d’assurer le bon développement de leur carrière en ne s’écartant pas trop de la pensée « acceptable » dans leurs universités, think-tanks et autres ONG (je parle là des universitaires, chercheurs, enseignants-chercheurs, maîtres de conférence, politistes et politologues, docteurs et doctorants), ils font preuve d’une extrême suffisance, d’un conformisme stupéfiant.
Comment ne pas sentir ses cheveux se hérisser lorsqu’on voit telle revue, censément de « critique communiste » (mais sans rapport avec le parti du même nom) reprendre sans une once de recul la version manipulatrice des « anti-néolibéraux (vénézuéliens) haut de gamme » Edgardo Lander, Nicmer Evans ou Marea socialista sur le saccage par Maduro de l’ « Arc minier de l’Orénoque » – au mépris de l’Histoire longue de la région et de faits que n’importe quel observateur de bonne foi peut observer (à condition bien entendu de ne pas craindre la transpiration) ?
Comment ne pas lâcher un soupire accablé lorsque les mêmes, reprenant le discours qui, il y a cent cinquante ans, qualifiait les communards de « racaille », diffusent le discours de la droite vénézuélienne sur la « dérive autoritaire » du « régime » et traitent de « paramilitaires » les « colectivos » ? L’une des expressions de l’organisation populaire, certes parfois radicale (est-ce un péché dans un tel contexte ?), mais qui ne comporte pas plus d’éléments violents, dangereux, incontrôlables que, disons… les « gilets jaunes » dans leurs rangs. Pourquoi faire abstraction de cette réalité ? Des conseils communaux ? Des communes ? Des organisations sociales de base ? Du peuple qui se mobilise et résiste aux côtés du pouvoir – sans lui ménager ses critiques, mais sans jouer ni les « commissaires politiques » ni les donneurs de leçons.
Bien entendu, fréquenter les « barrios » et le « campo » oblige à relativiser plutôt que de se référer en permanence à un absolu fantasmé. D’où le refus de se frotter au clair obscur de la vraie vie. Il est tellement plus confortable de critiquer depuis une perspective théorique tout en – pour les « révolutionnaires professionnels » – organisant des colloques, écrivant des textes, voire des livres pleins d’empathie sur Salvador Allende ou (le pacifique ?) Che Guevara !
Au-delà des simagrées et des contorsions, entonner le refrain de plus en plus à la mode « ni Maduro ni Guaido » – l’équivalent gauchouillard du « en même temps » macronien – c’est rejoindre le camp des charognards conservateurs et réactionnaires qui espèrent une défaite succulente des « bolivariens ». Quand bien même, pour sauver les apparences, au moment où de sombres nuages s’amoncellent, est lancé un traditionnel « Non à une intervention de l’impérialisme américain » ! La belle affaire… Tout le discours qui a précédé a préparé le terrain en cassant, au sein de la gauche, les solidarités. Et alors, pourtant, que les masques sont tombés : sans même se fendre d’un communiqué condamnant avec la plus extrême vigueur son « auto-proclamation », son appel aux sanctions étatsuniennes qui asphyxient le pays et martyrisent les secteurs populaires, et même à une intervention « militaro-humanitaire », les Nicmer Evans, Edgardo Lander, Gonzalo Gómez (Aporrea et Marea socialista) et autres Hector Navarro – les ténors du pseudo « chavisme critique » ! – se sont déjà précipités pour dialoguer avec Guaido.
TD – On te rétorquera néanmoins que la critique est nécessaire face aux multiples problèmes non réglés…
ML – Qui a prétendu le contraire ? Nul hasard si, dans ce livre, tout un chapitre est consacré – et sans prendre de pincettes ! – à la corruption. Si le rôle nuisible de la « bolibourgeoisie » et de la bureaucratie est régulièrement évoqué. Si certaines erreurs de Chávez (et non uniquement de Maduro !) sont pointées du doigt. Si… De là à jeter le bébé avec l’eau du bain, il y a un pas que, effectivement, je ne franchis pas. Lorsqu’un gamin avec une verrue noire sur le nez est férocement agressé par une sombre brute, la priorité est de défendre le gamin, pas de répéter en boucle, en restant tranquillement à l’écart, « beurk, il a une verrue sur le nez ! ».
TD – Tout de même, alors que de la droite à une certaine extrême gauche, une quasi unanimité dénonce le gouvernement vénézuélien, n’es-tu jamais saisi par le doute ? N’as-tu pas peur de te tromper ?
ML – Je doute en permanence. Je ne cesse de m’interroger. Le journaliste ne sait pas tout. Il rend compte des éléments dont il dispose, à un moment donné, pour expliquer une situation donnée. Ce n’est pas toujours facile. Au milieu des interactions, des circonstances, des émotions, des événements, tout se révèle sujet à interprétations. Sachant que, comme l’a dit Jean-Luc Mélenchon, « recopier et répéter est moins dangereux que de dire quelque chose en étant seul à le faire ».
Toutefois, un épisode de ma vie professionnelle m’a marqué profondément. En 1982, après m’être fait remarquer par un livre-reportage – Sucre amer – sur les effroyables conditions, un véritable esclavage, dans lesquelles travaillaient les Haïtiens des plantations de canne à sucre dominicaines, je suis parti au Salvador avec dans la poche un contrat des Editions du Seuil pour couvrir le conflit armé qui déchirait ce pays. J’y suis resté trois mois, dont trois grandes semaines physiquement éprouvantes au sein de la guérilla du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN). A mon retour à Paris, et lorsque j’ai rendu mon manuscrit, le Seuil a refusé de le publier, estimant qu’il était trop favorable aux thèses de l’opposition armée – considérée alors par beaucoup comme « polpotienne » et composée de « Khmers rouges » extrêmement dangereux. Le livre – Los Compañeros – a finalement été publié par une maison d’édition beaucoup plus modeste (Encre), ce qui n’a bien sûr pas favorisé sa diffusion.
Le conflit s’est terminé en 1992. Lorsque la Commission de la vérité de l’ONU a rendu son rapport, celui-ci a confirmé tout ce que j’avais écrit sur l’écrasante responsabilité de l’oligarchie, de l’armée (formée et encadrée par les Etats-Unis) et des escadrons de la mort dans les violations des droits humains. Bien que très minoritaire et contesté dans mon analyse, je ne m’étais pas trompé. Depuis ce jour, et fort de cette expérience, je ne cède ni à la pression générale, ni aux critiques, ni aux insultes, ni même à la perte de certains amis si, après avoir travaillé le plus sérieusement possible, j’estime, en conscience, que j’ai raison. Je peux certes me tromper. Mais, fussent-ils en groupes, en ligues et en processions, les autres aussi !
TD – Le média d’investigation Mediapart, salutaire quand il combat la corruption et la répression en « macronie », a par contre repris la ligne d’Edwy Plenel sur le Venezuela quand il dirigeait la rédaction du Monde, et fait beaucoup d’efforts pour convaincre le lectorat progressiste que ce pays est une dictature, avec pour preuve les dénonciations d’Amnesty International et de Human Rights Watch. Qu’en penses-tu ?
ML – Il y a quelques années, s’en prendre à Reporters sans Frontières et à son « caudillo » d’extrême droite Robert Ménard était très mal vu. A quelques-uns – je pense au Diplo, à Acrimed, à Maxime Vivas (du Grand Soir)i – (1), nous l’avons fait et avons dû subir des critiques acérées. Depuis, la vérité a éclaté sur Ménard – mais personne ne nous a présenté des excuses ! Comparaison n’étant pas raison, je ne comparerai évidemment pas l’idéologie des dirigeants d’Amnesty International à celle de Ménard. Toutefois, il existe une dérive de ces organisations de défense des droits humains. Au risque de choquer – une fois de plus ! –, je consacre un chapitre à ce sujet. Derrière ces bureaucraties respectées (et, sur de nombreux points, à juste titre), se cache un fonctionnement très problématique. Qui les informe ? Des ONG locales. Au Venezuela, Provea et le Foro Penal qui, avant d’être des organisations de défense des droits de l’homme, sont très clairement des organisations d’opposition. Financées par… (je laisse aux lecteurs le soin de découvrir les dessous de ces majuscules humanitaires à forts relents idéologiques qui méritent questionnements).
TD – Dans les années 70 nul n’aurait pensé dire « ni Allende, ni Nixon » comme on dit aujourd’hui « ni Maduro, ni Trump ». Après avoir occulté vingt ans de démocratie participative, les grands médias transforment aujourd’hui les effets en… causes de la guerre économique. N’est-il pas temps que les progressistes songent à démocratiser radicalement la propriété des médias, à fonder de nouvelles écoles de journalisme hors marché, à créer un puissant réseau de médias associatifs et, surtout, un nouveau type, socialement organisateur, de technologies qui nous libèrent des réseaux sociaux inventés par les Etats-Unis ?
ML – Tout à fait Thierry (comme disait Jean-Michel Larqué) ! La réponse est déjà dans ta question.
(1) i Action, Critique, Médias : https://www.acrimed.org/ ; Maxime Vivas, La face cachée de Reporters sans frontières, Aden, Bruxelles, 2007.
Le site Mémoire des Luttes publie en exclusivité les « bonnes feuilles » de « Venezuela. Chronique d’une déstabilisation » : « Nicolás » constitue le huitième chapitre de l’ouvrage.
1 avril 2019
URL de cet article: https://wp.me/p2ahp2-4Dc
Del mismo autor
- « Venezuela, chronique d’une déstabilisation ». 02/04/2019
- Povo bolivariano inflige nova derrota à mídia ocidental 28/02/2019
- Le peuple bolivarien inflige une nouvelle défaite aux médias occidentaux 25/02/2019
- De Trump à Macron, les grands cimetières sous la « une » 15/02/2019
- Nicolas Maduro est réélu Président de la République avec 68 % des voix 21/05/2018
- L’interdiction d’un parti qui n’existe pas 30/01/2018
- Nouveau triomphe chaviste aux élections municipales du Venezuela 11/12/2017
- Large victoire du chavisme et… nouvelle défaite de la droite et des médias 16/10/2017
- Comuna, tiempo y televisión 21/09/2017
- l’indulgence de la presse française (et d’une partie de la gauche) pour la violence d’extrême droite 17/08/2017








